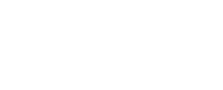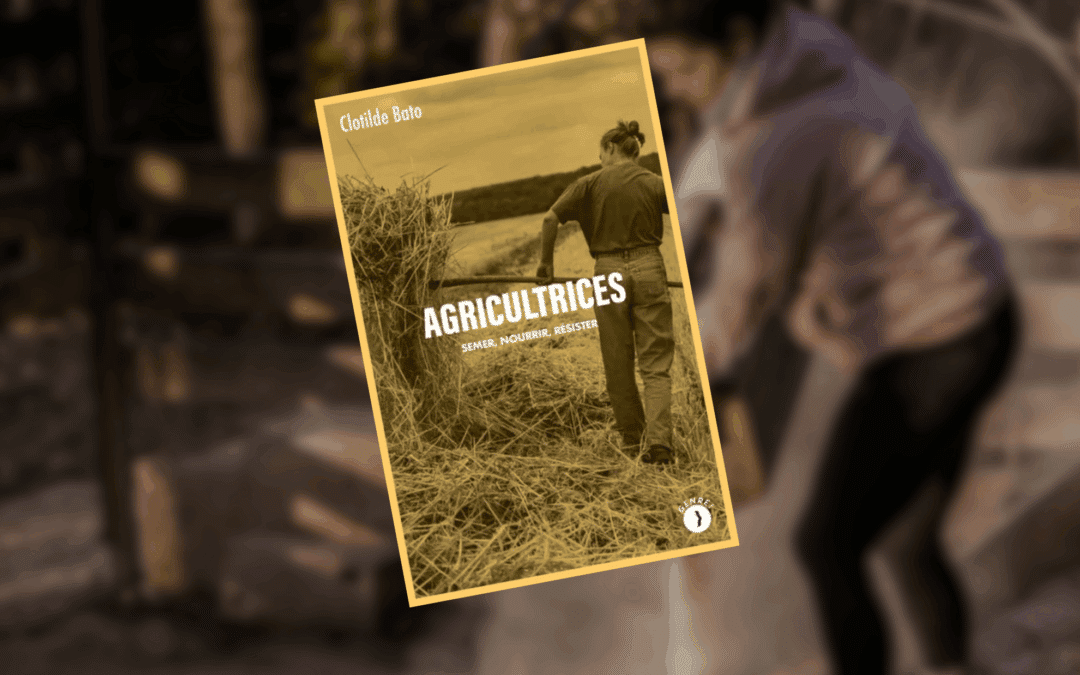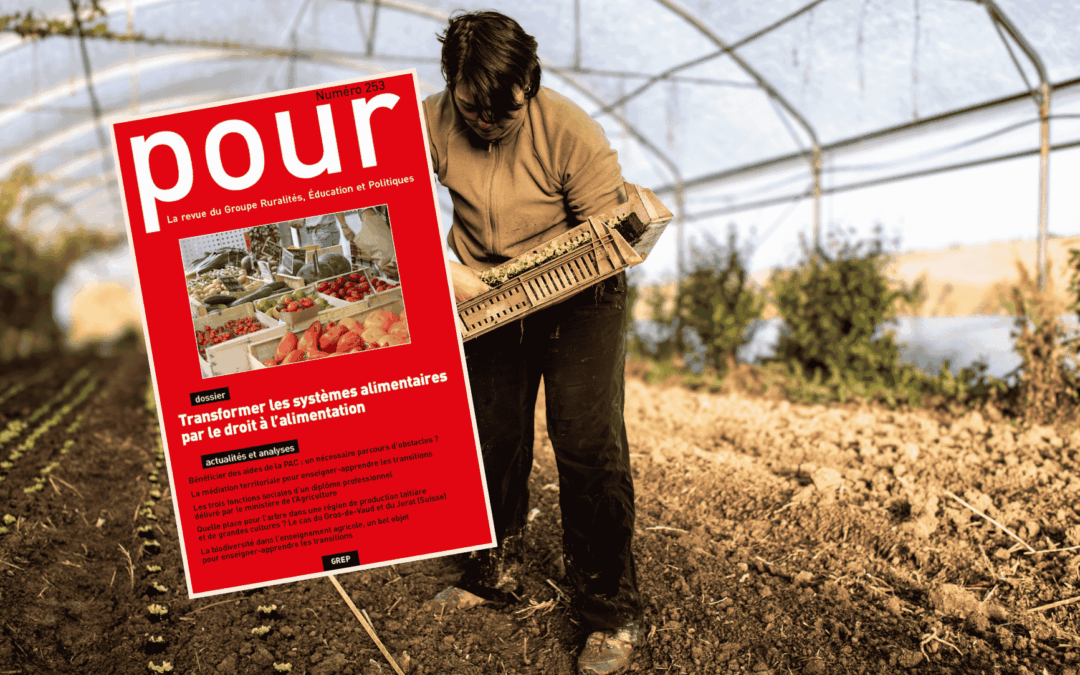Dans de nombreux pays, les politiques agricoles restent étroitement liées aux intérêts économiques. Les accords de libre-échange et l’influence des lobbys orientent trop souvent les priorités vers la rentabilité immédiate, au détriment de l’intérêt général. L’alimentation fait de plus l’objet d’une spéculation importante soumises aux aléas politiques et économiques décorrélés de la réalité de la production locale. Cette logique fragilise les communautés rurales et accentue les inégalités, avec des effets particulièrement marqués dans les pays où l’histoire agricole a été modelée par des rapports de domination.
En Inde, l’héritage colonial a façonné les terres agricoles pour servir les échanges commerciaux britanniques, reléguant au second plan les cultures vivrières, essentielles à l’autonomie alimentaire des populations. Cette transformation s’est renforcée avec la Révolution Verte dans les années 1960-70. Présentée comme une solution miracle face à la faim, elle a imposé un modèle agricole intensif, basé sur les intrants chimiques, la monoculture et la dépendance aux marchés mondiaux. Elle a permis d’augmenter la production agricole du pays mais non sans conséquences. Aujourd’hui, de nombreux·ses paysan·nes se retrouvent face à une impasse : sols appauvris, endettement, ressources naturelles fragilisées et prix de vente insuffisants pour vivre dignement de leur travail.
C’est dans ce contexte que la coopération internationale joue un rôle essentiel. Si elle soutient des initiatives locales qui répondent à ces enjeux, elle peut aider les communautés à préserver les ressources naturelles et valoriser leurs savoirs faires. . L’accompagnement technique, organisationnel et financier apporté peut ainsi renforcer la capacité d’agir et la reconnaissance sociale des paysan·nes. Dans le cas de SOL, cette coopération s’exprime par une relation de réciprocité et d’enseignement mutuels avec nos partenaires locaux.
Au Bihar, État du nord-est de l’Inde, SOL accompagne depuis 2022 un mouvement citoyen en faveur de l’agroécologie, « Regenerative Bihar ». Par des actions concrètes, le projet œuvre à renforcer la résilience des paysan·nes et à promouvoir un modèle agricole qui leur permette de vivre dignement.
Parmi ces actions, il appuie les élus locaux pour que les enjeux agricoles et climatiques soient intégrés dans les politiques publiques. Il valorise également les savoirs traditionnels, en réintroduisant dans les systèmes agricoles des variétés alimentaires indigènes et oubliées. Des centres de formation paysans sont de plus créés pour transmettre et expérimenter des pratiques agroécologiques autour des semences paysannes, de l’agroforesterie ou de l’entrepreneuriat féminin. Le projet agit aussi dans le domaine éducatif, avec l’intégration d’un programme complet d’agroécologie et la mise en place de jardins potagers dans les écoles publiques.
Ces actions répondent à des besoins immédiats tout en ouvrant des perspectives à long terme. Elles montrent que les solutions aux crises agricoles et climatiques existent déjà sur le terrain, portées par celles et ceux qui vivent ces réalités au quotidien. La coopération internationale agit alors comme un relais, capable de donner plus de visibilité à ces initiatives et d’inspirer des projets à plus large échelle.
Elle s’exprime d’autant plus lors des échanges entre pays et entre continents qui peuvent être de puissants vecteurs d’innovation et de changement de pratiques qui dépassent les frontières comme lors des Rencontres Internationales des Semences Paysannes que nous avons co-organisées en 2024 . La coopération internationale permet ainsi aux sociétés civiles de dialoguer, de s’entraider et de construire ensemble des modèles plus durables pour les générations actuelles et futures.