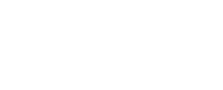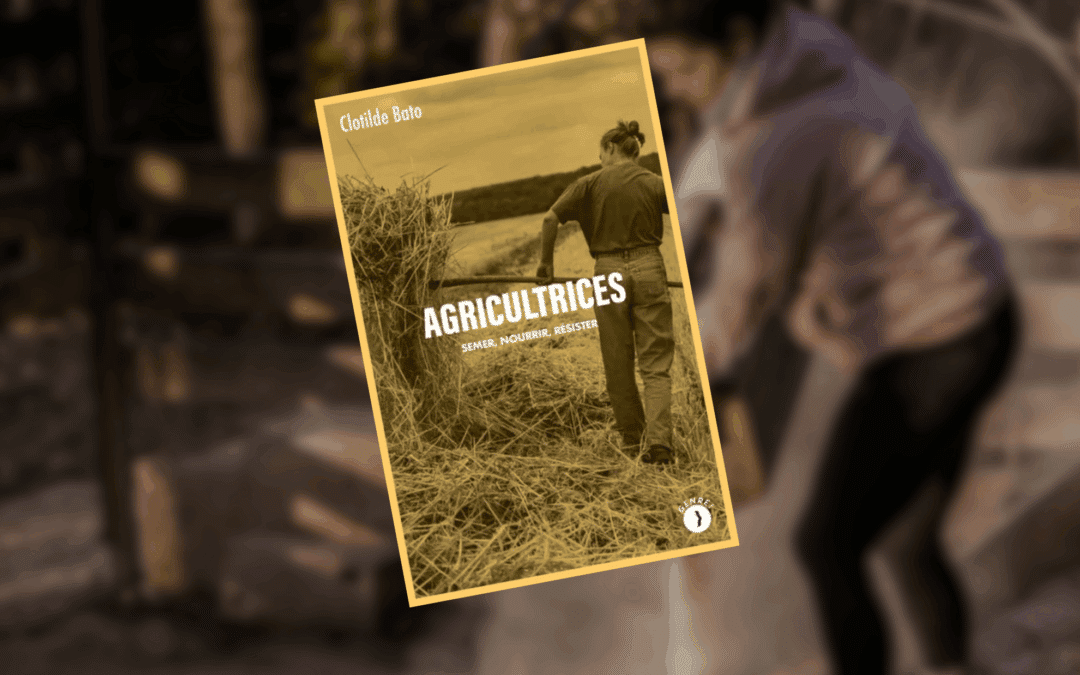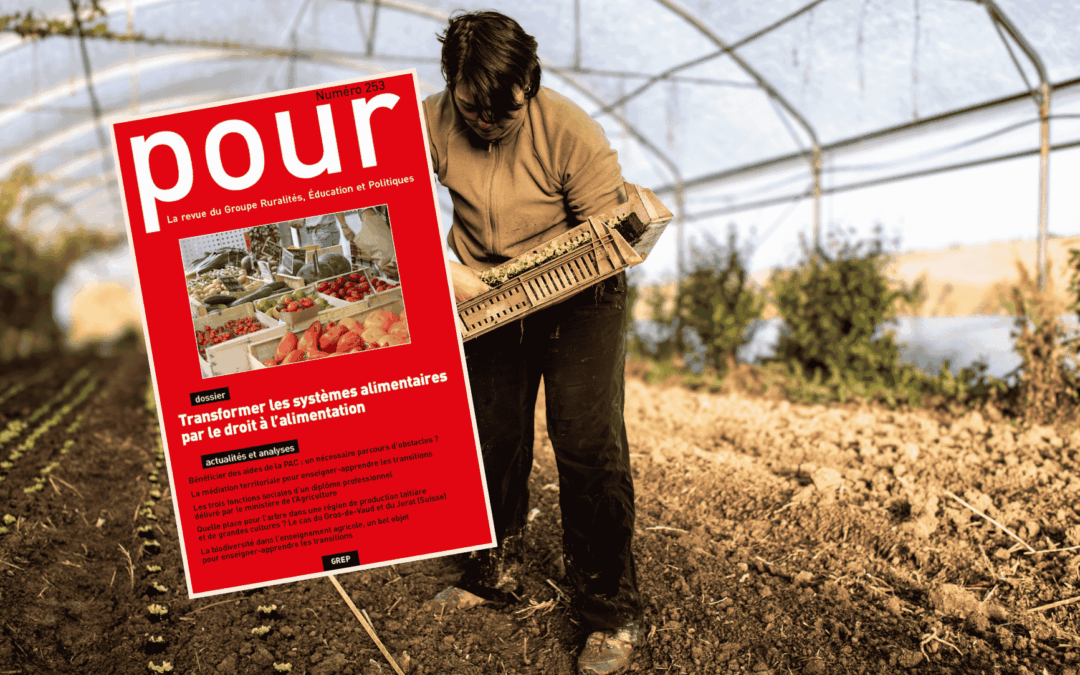Au Sénégal, les céréales locales, comme le mil ou le maïs, sont peu transformées alors même que c’est un levier pour renforcer la souveraineté alimentaire du pays. La production de pain par exemple repose presque exclusivement sur l’utilisation de farine de blé importé, alors que les farines de mil ou de maïs peuvent aussi être panifiables. Pour changer cela, les producteurs·rices de céréales, ainsi que celles et ceux qui les transforment, s’organisent. En travaillant ensemble et en structurant leurs activités, ils et elles créent une chaîne de valeur pour transformer les céréales en farine panifiable et diffuser leur utilisation, tout en créant une économie circulaire et en renforçant ce faisant l’autonomie des territoires.
Cette chaîne de valeur relie toutes les étapes de production, de transformation et de consommation des céréales locales : de l’exploitation familiale aux écoles et marchés où les artisans boulangers et les femmes transformatrices vendent leurs produits, une synergie se crée, qui repose sur une prise de conscience collective : chacun·e dépend de l’autre. Les pratiques agroécologiques se diffusent, notamment via des formations entre pair·e·s : elles peuvent être encadrées par les organisations paysannes ou organisées de manière volontaire et spontanée, en particulier entre les femmes transformatrices. Petit à petit, les populations rurales s’approprient les pratiques.
Les minoteries, où les céréales sont transformées en farines, sont un pilier de cette chaîne de valeur. Elles offrent un nouveau débouché commercial aux producteurs·rices, qui en tirent des nouveaux revenus, et rendent plus accessibles les farines de mil et de maïs aux boulangers et femmes transformatrices qui peuvent s’approvisionner proche de chez elles·eux et à moindre coût.
S’organiser autour d’une chaîne de valeur locale permet aussi aux différent·e·s acteurs·rices de s’organiser collectivement pour faire valoir leurs intérêts dans des espaces de concertation et de prise de décision démocratiques et inclusifs où la responsabilité est partagée (concernant par exemple la fixation des prix des farines). Cela permet aussi de renforcer leurs capacités de négociation face à des acteurs industriels et commerciaux dotés d’une représentation structurée.
Le tout renforce la cohésion sociale et crée de nouvelles opportunités d’emplois et de revenus, qui sont autant d’alternatives au départ vers les grandes villes, surtout pour les femmes et les jeunes, qui ont ainsi plus de choix pour leur avenir. Les bénéfices économiques qu’engendre la chaîne de valeur permettent aux acteurs·rices d’aller au-delà de la subsistance en investissant dans leur activité professionnelle et pour leur famille, et en épargnant.